MARINE ANCIENNE
| Lettre M |
|
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre M |
|
| Macrotier |
ou maquereautier. Petit cotre de la région de Saint-Malo, armé pour la pêche au maquereau. |
| Mahonne | 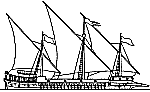 • La mahonne, ou mahon, était une sorte de galéasse utilisée par les Turcs. • Aujourd'hui, une mahonne est un chaland de port à formes très arrondies, ponté, dépourvu de moyens de propulsion, utilisé en Méditerranée pour le chargement des grands bâtiments. • Chaland de petit tonnage utilisé au XVIe siècle par les pilleurs de haute mer de Nouvelle Ecosse et qui donna son nom à la baie de Mahoné (Mahone Bay, Canada). |
| Maître d'équipage | Gradé expérimenté ayant l'autorité directe sur les matelots. |
| Mangeovent | ou manjo-vènt. Tourmentin, sur les bateaux latins. |
| Mantelet |
XIIe siècle. Diminutif de manteau. Sur les navires de guerre à voiles, volet de fermeture des sabords des batteries basses, qui pivotait sur des gonds placés à sa partie supérieure. Construit en bois, il était de la même épaisseur que les bordages de la coque et renforcé ; on le manœuvrait à l'aide de rabans. Selon l'état de la mer, du vent et l'allure du navire, il fallait rentrer les canons et fermer les sabords des batteries basses des vaisseaux. Faute d'avoir exécuté cette manœuvre en temps opportun, bien des vaisseaux ont chaviré sous voiles. Ce fut notamment le cas du Thésée et du Superbe, dans le mauvais temps, à la bataille des Cardinaux (1759). |
| Maraboutin | Terme désignant, en Provence, la voile de cape des bateaux latins. |
| Marchepied | Sur les voiliers à gréement carré, cordage placé sous une vergue et allant d'une extrémité de la vergue à son milieu. Les marchepieds sont soutenus de distance en distance par des étriers, de façon que les matelots, en y posant les pieds, se trouvent à bonne hauteur pour pouvoir enverguer, déverguer, serrer les voiles, y prendre des ris, pousser ou rentrer les bouts-dehors. |
| Marquise | Voile d'étai située au-dessus du foc d'artimon d'un grand voilier. |
| Matafian | Mot provençal pour désigner les rabans d'envergure sur les voiles latines. |
| Méjane | ou mitjana. Voile latine la plus en arrière, comme un tapecul, sur les bateaux latins. |
| Mestre | Mât principal sur une galère. Synonyme de grand-voile sur un bateau de Méditerranée portant un gréement latin. |
| Misaine | Voile inférieure du premier mât sur les navires gréés à traits carrés (sauf sur les deux-mâts). |
| Mouche | Mouche d'escadre. Petit bâtiment léger et rapide, à partir du XVIIIe siècle, qui était détaché d'une armée navale pour suivre, observer un ennemi, et rendre compte de sa marche et de ses mouvements. |
| Mourre de Pouar |
Signifie groin de porc, en raison du court éperon qu'il porte à l'étrave. Bateau de pêche côtière le plus caractéristique de la Méditerranée, que l'on rencontrait de Toulon à Sète, et qui s’est transformé au cours du XIXe siècle. Fin et léger au début pour favoriser l’aviron, il s'est élargi et alourdi progressivement. Bateau de travail aux formes lourdes, il se caractérise par son mât incliné vers l'arrière et la légère dissymétrie de sa coque (avant plus élancé, arrière plus volumineux et plus haut), qui lui permet d’embarquer une grande quantité de filets sans faire plonger exagérément l’arrière du bateau. Le mourre de pouar pratiquait plusieurs types de pêche, les plus petits la pêche à la palangre, tandis que les plus volumineux, pouvant atteindre 9 mètres, ont exercé la pêche au bœuf au cours du XIXe siècle. Il est gréé d'une voile latine souvent complétée par une petite voile triangulaire placée à l’avant (foc). |
| Muleta du Tage | Portugal. Fin du XIXe début XXe siècle. Bateau de pêche portugais qui réunit les caractéristiques de construction des navires de trois peuples marins, les Normands, les Arabes et les Hollandais. Réputé pour sa bonne tenue à la mer, son étrave courbe et haute lui permettait de franchir les vagues élevées des barres du Tage. La coque concave supportait un gréement compliqué et morcelé, une extravagante voilure, qui comprenait jusqu'à douze pièces et lui permettait de disposer ainsi d'une grande puissance pour traîner la drague ou le filet. |
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre M |
ACCUEIL
La construction du Mandragore 2
- Toutes les étapes de la construction, en images
- Hangar
- Mannequin
- Stratification de la coque
- Retournement
- Structures
- Pontage
- Déménagement du chantier
- Habillage du pont
- Incendie et réparations
- Pose des moteurs
- Aménagements
Les plans
L'histoire du Mandragore 1
- Présentation du bateau
- La construction
- Les traversées
- France-Grèce
- Grèce-Gibraltar
- Gibraltar-Dakar
- Dakar-Rio
- Rio-Capetown
- Le naufrage
Jonques et gréement de jonque
- Introduction au gréement de jonque
- Les différentes formes de voiles
- Evolution moderne du gréement
- Quelques aspects techniques
- Photos de jonques
- La Junk Rig Association
- L'association Voiles de Jonques
- Les jonques de Jean-Claude Michaud
- Témoignages
Projets
Encyclopédie de la mer
- Dictionnaire Français-Anglais des termes marins
- Dictionnaire Anglais-Français des termes marins
- Lexique général des termes marins
- Marine ancienne : termes et bateaux
- Lexique des termes en charpente navale
- Glossaire du menuisier charpentier
- Lexique des termes de météo
Le bois
- Vignettes des principales essences de bois du monde
- Les bois utilisée en construction navale
- Bois et développement durable
Pavillonnerie
La construction amateur
- L'Unité Amateur
- Réglementation : la Division 224, Edition du 30 septembre 2004, parue au J.O. le 28 OCTOBRE 2004
- Ancienne Division 224
- Liens sur la construction amateur












