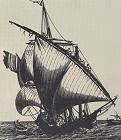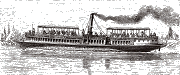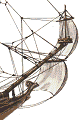MARINE ANCIENNE
| Lettre B Page 2 |
|
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre B |
|
| Barque | Depuis le XIXe siècle, le mot barque désigne un type de gréement. Sur un trois-mâts, un quatre-mâts ou un cinq-mâts, les deux, trois ou quatre premiers mâts portent des voiles carrées, le dernier des voiles auriques. |
| Barque (trois mâts) |
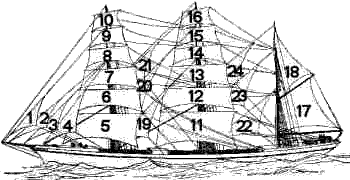 1-Clinfoc 2-Faux Foc 3-Grand Foc 4-Petit Foc
5-Misaine 6-Petit Hunier fixe 7-Petit hunier volant 8-Petit Perroquet fixe 9-Petit Perroquet volant 10-Petit Cacatois 11-Grand-Voile 12-Grand Hunier fixe 13-Grand Hunier volant 14-Grand Perroquet fixe 15-Grand Perroquet volant 16-Grand Cacatois 17-Brigantine 18-Flèche d'Artimon 19-Grand-Voile d'étai 20-Voile d'étai de hune 21-Voile d'étai de perroquet 22-Foc d'artimon 23-Voile d'étai de marquise 24-Diablotin • Belem, trois-mâts barque, France • Belem, site officiel • Sagres, trois-mâts barque, Portugal • Statsraad Lehmkuhl, trois-mâts barque, Norvège • Dunbrody, trois-mâts barque, Irlande • Eagle, trois-mâts barque, Etats-Unis • Friendship, trois-mâts barque, Etats-Unis • Kaskelot, trois-mâts barque, Grande-Bretagne • Lord Nelson, trois-mâts barque, Grande-Bretagne • Picton Castle, trois-mâts barque, Iles Cook |
| Barque catalane | Voir Catalane. |
| Barque du Léman | Grande barque de transport utilisée sur le lac Léman, apparue à la fin du XVe siècle. Sa coque très large et son pont débordant révèlent une origine architecturale inspirée de la galère. Elle fut gréée de deux voiles latines, importées en Suisse à la fin du XVIe siècle par un constructeur vénitien. Les barques assuraient surtout le transport de pierres de construction et de bois de chauffage. |
| Barque longue |
Sur l'Atlantique et les mers bordant les côtes du nord de l'Europe, la barque longue apparut d'abord à Dunkerque à la fin du XVIIe siècle. Gréée en voiles latines, elle serrait bien le vent et était donc relativement rapide. Les premières jaugeaient jusqu'à 100 tonneaux et, à demi pontées, ne portaient que deux mâts. Armées de quatre à dix canons, elles remplissaient le rôle de barques d'avis (ou avisos) entre les ports et les escadres. Utilisées pour le commerce, elles atteignirent 200 tonneaux, furent entièrement pontées et eurent un troisième mât. Rapides et agiles, elles servirent au commerce interlope (activité qui se développa parallèlement au commerce officiel à l'époque où une cargaison issue d'une colonie ne pouvait être débarquée que d'un navire battant le pavillon de la métropole où il déchargeait). Du XVIIe au XVIIIe siècle, la barque longue était assimilée à une corvette légère. En 1746, le terme de barque longue disparut, celui de corvette étant seul retenu. |
| Barque de Méditerranée |
Elle jaugeait de 100 à 150 tonneaux et servait, aux XVIe et XVIIe siècles, aussi bien à la guerre qu'au commerce sur toutes les côtes, de la Turquie à l'Espagne. C'était un voilier entièrement ponté, équipé de trois mâts à pible (c'est-à-dire continus, sans hunes ni mâts de hune) et portant, à l'origine, uniquement des voiles latines. Comme d'autres types spécifiquement méditerranéens, cette embarcation ne possédait pas de beaupré et son mât avant (mât de trinquet) était fortement incliné vers l'avant ; la barque de la Méditerranée a subsisté comme caboteur jusqu'au milieu du XIXe siècle, mais, entre-temps, elle avait équipé son grand mât de voiles carrées. |
| Barquet | Petite embarcation à fond plat des étangs du Languedoc, utilisée à la voile ou à l'aviron pour la pêche. |
| Barquette |
Petit bateau creux à arrière pointu, utilisé pour la pêche côtière, en Méditerranée. De cinq à sept mètres de long, la barquette est pourvue d'une coque assez large et relativement symétrique avec des extrémités nettement pincées. Le mât, situé en avant du bateau, laisse place à une vaste ouverture de cale sur ces embarcations toujours pontées. |
| Barrée (voile ...) |
La vergue du mât d'artimon, ou vergue barrée, ne comportait normalement pas de voile. Cependant, certains navires tels que les clippers pouvaient exceptionnellement en comporter une. Cette voile prenait alors le nom de voile barrée. |
| Bas-mât | Partie inférieure d'un mât composé. - Sa partie inférieure, de forme carrée, est plantée dans l'emplanture de la carlingue, par le tenon d'emplanture. La partie du mât située sous le pont s'appelle le pied du mât. - Proche du sommet, un décrochement appelé la noix ou l'épaulette, permet le capelage des haubans. - La partie située entre la noix et le sommet du mât s'appelle le ton du mât. Elle est de section carrée à angles coupés. - Sur la tête du mât, en forme de tenon carré, est placé le chouquet ou chouque ou tête de more. |
| Basse voile | On nommait basses voiles, les voiles carrées inférieures, c'est-à-dire la misaine, la grand-voile et, exceptionnellement la voile barrée. Dans une goélette, les basses voiles sont : la grand-voile, la misaine-goélette, la trinquette, le foc. |
| Bastingage | A l'origine, désignait, sur les bâtiments de guerre, galères ou navires de haut bord, toute protection placée à l'avant ou sur les bords pour défendre l'équipage contre les flèches, puis contre la mousqueterie. A partir du XVIIe siècle, c'est un ensemble de filets, disposés le long du bord et maintenus par des montants et des filières. Les hamacs des marins, qu'on y rangeait le jour, servaient ainsi de protection en cas de combat. Par la suite, ces filets furent remplacés par des caissons en bois ou en fer. Après leur disparition, on appela ainsi la partie du bordé qui dépasse le niveau du pont et forme un parapet tout autour du navire. |
| Bateau berckois |
Fort bateau bordé à clin, non ponté, équipé d'une grande dérive sabre, gréé en bourcet-malet (misaine et tape-cul au tiers), utilisé pour la pêche côtière en mer du Nord. Il est tiré à terre après chaque marée. A la fin du siècle dernier la flottille berckoise comptait plus de 110 navires. |
| Bateau-bœuf |
Forte embarcation d'origine sétoise, qui résulterait d'une évolution des tartanes de pêche provençales, adaptées pour pratiquer la pêche au bœuf dans le golfe du Lion. Une technique de pêche qui se pratiquait par deux embarcations similaires tractant ensemble un seul et même chalut de fond, nommé gangui. Le bateau-bœuf mesurait 16 mètres de long, 5 mètres de large, et gréait une voile latine et un foc. |
| Bateau-mouche |
Bateau à vapeur, faisant le service d'omnibus sur le fleuve (Larousse Ed.1934). Lors de l'Exposition Universelle de 1867, la Compagnie des Mouches, de Lyon, fut sollicitée pour ouvrir une succursale à Paris. Ce service de bateaux-mouches connut un grand succès, et en 1876, il s'étendait sur 15 km, du pont de Bercy au Point-du-Jour, chaque bateau transportant entre 150 et 200 voyageurs. |
| Bati-sarti | Terme provençal désignant les estropes ou chaînes à cabillot fixées à la lisse et servant à capeler les palans (sarti) de haubans sur les bateaux latins. |
| Batteliku | Embarcation légère du Pays basque, utilisée essentiellement à l'aviron pour la pêche, parfois gréée d'un mât court et d'une voile au tiers. |
| Batterie | Terme apparu au XIIIe siècle, dérivé de battre. Rangée de bouches à feu et, par métonymie, pont où se trouvaient les rangées de bouches à feu. Un navire pouvait avoir plusieurs batteries. La batterie basse était la plus proche de l'eau (ou première batterie), la batterie haute la plus proche du pont. Les canons du château avant et du gaillard arrière formaient les batteries des gaillards. Sur les grands voiliers de la fin du XIXe siècle, ce terme s'appliquait surtout à l'ensemble de la peinture blanche et noire extérieure qui figurait une ligne de sabords. On disait d'un navire peint de cette façon : un navire à batterie. |
| Bau | Terme utilisé pour désigner le barrot de pont, jusqu'au début du XXe siècle. (voir lexique des termes marins) |
| Bautier |
Vers 1880, ce sloop de 9 à 11m fait irruption à Barfleur (NE de la presqu'île du Cotentin) pour le travail des palangres appelées baux (qui donneront le nom à ces bateaux) et remplace les bisquines locales. Le bautier est très apprécié pour ses qualités nautiques, il est ardent, très bon marcheur, très toilé, possède un très long plan de dérive et un bon couple de rappel. Il est fin et émacié à l'avant, ventru (gage de stabilité) au milieu et très fuyant à l'arrière. Synonyme : cordier. |
| Beaupré | Espar qui pointe à l'avant des voiliers, généralement dans l'axe au-dessus de l'étrave, parfois légèrement en abord, avec un angle variable. Autrefois qualifié de mât, il n'a cependant jamais été compté comme tel : un trois-mâts a trois mâts et un beaupré.
Apparu au XIIe siècle, le beaupré, mince et court, servait alors à établir les boulines. A la fin du XVe siècle, il devint beaucoup plus robuste, pour recevoir l'attache des étais du mât avant. Au XVIe siècle, on suspendit au-dessous une vergue portant une voile carrée, la civadière. Au XVIIe siècle, on établit à son extrémité une hune avec un petit mât vertical portant une voile carrée : le perroquet de beaupré, ou beauprette ; celui-ci disparut au XVIIIe siècle, et le mâtereau qui le portait fut remplacé par un espar, le bout-dehors du beaupré, auquel sont fixées les amures des focs, voiles qui apparaissent à cette époque. Ceci ajoute aux efforts qu'il supporte, d'autant plus que le mât, gréé de voiles toujours plus hautes, devient de plus en plus grand. Pour lui permettre de tenir son rôle, devenu capital (les étais qui tiennent presque toute la mâture y sont fixés), on le maintient par des sous-barbes et des haubans fixés sur l'étrave et on dispose à sa base une armature de madriers. Etant donné le développement des voiles d'étais de l'avant, on prolongea son boutdehors par un bâton de foc, sur lequel on fixa la draille du clinfoc. A la fin du XIXe siècle apparurent les mâtures en tube d'acier, qui permettaient aux beaupré, boutdehors et bâton de foc de ne plus former qu'une seule pièce. |
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre B |
|
|
|
ACCUEIL
La construction du Mandragore 2
- Toutes les étapes de la construction, en images
- Hangar
- Mannequin
- Stratification de la coque
- Retournement
- Structures
- Pontage
- Déménagement du chantier
- Habillage du pont
- Incendie et réparations
- Pose des moteurs
- Aménagements
Les plans
L'histoire du Mandragore 1
- Présentation du bateau
- La construction
- Les traversées
- France-Grèce
- Grèce-Gibraltar
- Gibraltar-Dakar
- Dakar-Rio
- Rio-Capetown
- Le naufrage
Jonques et gréement de jonque
- Introduction au gréement de jonque
- Les différentes formes de voiles
- Evolution moderne du gréement
- Quelques aspects techniques
- Photos de jonques
- La Junk Rig Association
- L'association Voiles de Jonques
- Les jonques de Jean-Claude Michaud
- Témoignages
Projets
Encyclopédie de la mer
- Dictionnaire Français-Anglais des termes marins
- Dictionnaire Anglais-Français des termes marins
- Lexique général des termes marins
- Marine ancienne : termes et bateaux
- Lexique des termes en charpente navale
- Glossaire du menuisier charpentier
- Lexique des termes de météo
Le bois
- Vignettes des principales essences de bois du monde
- Les bois utilisée en construction navale
- Bois et développement durable
Pavillonnerie
La construction amateur
- L'Unité Amateur
- Réglementation : la Division 224, Edition du 30 septembre 2004, parue au J.O. le 28 OCTOBRE 2004
- Ancienne Division 224
- Liens sur la construction amateur