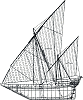MARINE ANCIENNE
| Lettre B Page 1 |
|
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre B |
|
| Bac | Embarcation à fond plat destinée au passage en rivière d'une berge à l'autre. Il est halé sur une cincenelle tendue en travers du cours d'eau. • Le bac à traille, ou simplement, traille. La traille repose sur le principe d'un cordage établi entre les rives, maintenu à une bonne hauteur au-dessus de l'eau par des pylônes en bois. L'embarcation servant à la traversée était elle-même reliée par un autre câble appelé traillon. • Le bac à vapeur. Deux types de bacs à vapeur vont apparaître avec l'introduction de la vapeur comme source d'énergie : les bacs à roue puis à hélices. |
| Bachet |  |
| Bacop | Barque à fond plat utilisée sur l'Aa, dans la région de Saint-Omer, pour le transport des produits maraîchers. |
| Baggala |
Baghla, Baggala ou Baggalah Boutre arabe de conception similaire au dhau, doté d'un château arrière copié sur celui des vaisseaux occidentaux du XVIIIe siècle. Il grée deux (parfois trois) mâts (à pible), avec des voiles arabes, jauge entre 200 et 400 tonneaux, et peut parfois atteindre 40 mètres de long. Le grand mât (le plus à l'avant) est penché vers l'avant. Il a un arrière surélevé, avec un gaillard et un tableau sculpté. |
| Bague | Sorte de mousqueton, fixé sur la ralingue d'envergure des voiles latines, pour les endrailler sur les étais ou sur les drailles. |
| Baille | Demi-tonneau à divers usage : réserve d'eau pour laver le pont, etc. La baille de combat contenait l'eau destinée à refroidir les canons ou à éteindre un incendie pendant une action navale. La baille à drisses recevait les lignes de sonde ou les drisses. |
| Balancelle |
Dénomination française d'un petit voilier pointu aux 2 extrémités, portant un ou deux mâts (dont un tape-cul nommé méjane), gréés de voiles latines, et pouvant border de douze à vingt avirons. Originaire de Naples (où il s'appelait parenzella), il s'est répandu au XIXe siècle le long des côtes méditerranéennes de France et d'Espagne. |
| Balaou | Petite goélette d'environ 25 m, à mâture très élevée et inclinée vers l'arrière, construite depuis le XVIIIe siècle dans les îles et sur les côtes de la mer des Antilles. Aussi rapide que le poisson dont elle tire son nom, elle était très appréciée par les contrebandiers. |
| Balcon | Plate forme avec rambarde sculptée, à l'arrière des navires du XVIIe et XVIIIe siècle. Elle jouxte la galerie qui elle, est fermée. |
| Baleinière |
Embarcation légère, résistante, de manœuvre facile, initialement utilisée pour la chasse à la baleine, et d'usage généralisé sur beaucoup de navires, en particulier comme embarcation de sauvetage. Les marines basques avaient certainement créé une industrie baleinière dès le XIIe siècle, et probablement même deux siècles auparavant. Pour chasser la baleine franche, ils employaient des embarcations à avirons ou baleinières. Les baleiniers, dans leurs canots non pontés, chassaient les baleines au harpon. A la fin du XVIIe siècle, les colons américains commencèrent à chasser les baleines franches au moyen de canots non pontés (baleinières), de harpons et de lances. Les méthodes de cette chasse côtière leur avaient probablement été enseignées par les Canadiens français qui, en 1690, avaient fait venir à Québec des harponneurs basques de Bayonne. Tous les navires, même non baleiniers, avaient généralement une baleinière ; à l'usage du capitaine par exemple, ou comme bateau de sauvetage, ce genre d'embarcation se manœuvrant facilement avec ses avirons ou ses voiles. Un navire baleinier en bois portait jusqu'à sept baleinières sur des bossoirs également en bois, parées à être amenées dès que la vigie, en haut du mât, signalait des baleines. Lorsque tous les canots étaient armés, il ne restait à bord du grand navire que trois ou quatre matelots pour manœuvrer et signaler les cétacés. Les baleinières mesuraient environ 9 m de long ; elles étaient pointues aux deux extrémités, avec un davier à côté de l'étrave pour laisser filer le câble du harpon ; l'embarcation gréait une voilure, mais celle-ci était généralement amenée, et le mât enlevé de son emplanture lors de l'approche finale, qui se faisait aux seuls avirons. L'équipage se composait de six hommes, y compris le patron, à l'arrière, qui gouvernait. • Stérenn
La baleinière Stérenn, de Lanester en Morbihan,lancée en 1998 sur plans américains. En République démocratique du Congo, le terme est employé pour désigner de petits paquebots fluviaux ou lacustres navigants sur le fleuve Congo ou ses affluents.
|
| Ballast | Sable, mâchefer ou cailloux employés depuis l'Antiquité pour servir de lest sur les navires et disposés au fond de la cale. On les a peu à peu remplacés, pour plus de propreté et de facilité de manipulation, par des pierres (lavées à l'eau douce), des gueuses de plomb, puis, de nos jours, par un lest fixe. |
| Balouette | Girouette décorée, typique des bateaux du Nord de la France. |
| Banc de quart | Plate-forme surélevée à l'arrière du bateau où se tenait l'officier de quart. |
| Bande | Au XVIe siècle, la bande était le bord d'un navire. Il donnait de la bande dans l'eau quand il penchait sous l'action du vent (voir lexique des termes marins). |
| Barcasse | Nom donné aux chalands non pontés, aux formes très lourdes et manœuvrés à l'aviron, qui franchissaient la barre sur les côtes du Maroc pour aller décharger les cargos ou les paquebots mouillés au-delà. |
| Barge | Du bas latin, barga. La barge était autrefois une sorte de barque gréée d'une voile carrée, utilisée pour la pêche en rivière, ou un voilier caboteur à fond plat, ou encore une embarcation d'apparat ou embarcation d'un amiral. |
| Barge de la Tamise |
Ce mot a désigné, d'après leur appellation anglaise, des voiliers caboteurs à fond plat, caractéristiques des parages de l'embouchure de la Tamise (Thames barge) ; leur régate annuelle avait fait en partie leur réputation. Les Barges de la Tamise assuraient le transport des marchandises le long des côtes Britanniques. Elles embarquaient d'énormes cargaisons de grain ou d'autres denrées. |
| Barinel |
Navire d'exploration portugais du début du XVe siècle. Plus gros que la barcha, à la poupe ronde, il était gréé d'un ou deux mâts à voiles carrées, le grand-mât étant placé au centre du navire. Des rames étaient utilisées en l'absence de vent ou à proximité des côtes. Le barinel était utilisé pour l'exploration des côtes africaines, mais ses difficultés à revenir de ses voyages, face au vent, en raison de ses voiles carrées, l'on fait remplacer par la caravelle à voiles latines. |
| Voir aussi : Lexique général des termes marins pour la lettre B |
|
|
|
ACCUEIL
La construction du Mandragore 2
- Toutes les étapes de la construction, en images
- Hangar
- Mannequin
- Stratification de la coque
- Retournement
- Structures
- Pontage
- Déménagement du chantier
- Habillage du pont
- Incendie et réparations
- Pose des moteurs
- Aménagements
Les plans
L'histoire du Mandragore 1
- Présentation du bateau
- La construction
- Les traversées
- France-Grèce
- Grèce-Gibraltar
- Gibraltar-Dakar
- Dakar-Rio
- Rio-Capetown
- Le naufrage
Jonques et gréement de jonque
- Introduction au gréement de jonque
- Les différentes formes de voiles
- Evolution moderne du gréement
- Quelques aspects techniques
- Photos de jonques
- La Junk Rig Association
- L'association Voiles de Jonques
- Les jonques de Jean-Claude Michaud
- Témoignages
Projets
Encyclopédie de la mer
- Dictionnaire Français-Anglais des termes marins
- Dictionnaire Anglais-Français des termes marins
- Lexique général des termes marins
- Marine ancienne : termes et bateaux
- Lexique des termes en charpente navale
- Glossaire du menuisier charpentier
- Lexique des termes de météo
Le bois
- Vignettes des principales essences de bois du monde
- Les bois utilisée en construction navale
- Bois et développement durable
Pavillonnerie
La construction amateur
- L'Unité Amateur
- Réglementation : la Division 224, Edition du 30 septembre 2004, parue au J.O. le 28 OCTOBRE 2004
- Ancienne Division 224
- Liens sur la construction amateur